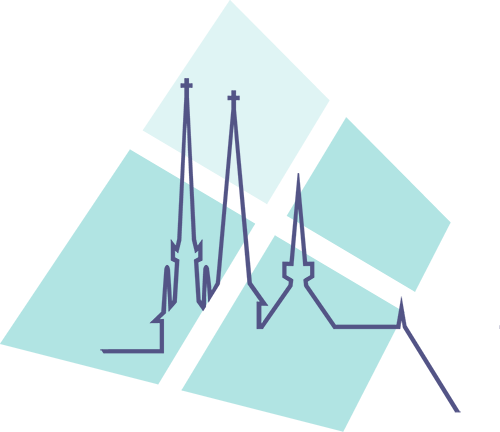Cercle judéo-chrétien : pour apprendre à mieux se connaître
Tous les mois, un petit groupe se réunit autour du Grand Rabbin de Luxembourg, Alain Nacache. Au programme, le livre de la Genèse.
Depuis une dizaine d’années, une grande salle de la synagogue de Luxembourg-Ville accueille une fois par mois pendant l’année scolaire une réunion un peu particulière. Sous la direction d’Alain Nacache, Grand Rabin de Luxembourg, une petite vingtaine de personnes se penche sur les textes de l’Ancien Testament. « L’étude des premiers chapitres du livre de la Genèse dans le texte en hébreu peut ouvrir des perspectives inattendues voire déstabilisantes au regard des certitudes établies sur la base de traductions peu rigoureuses ou idéologiquement orientées, indique la brochure du Centre de Formation Diocésain. Nous vous proposons de scruter le texte de ces premiers chapitres afin d’entrevoir des réflexions et des questionnements sur la nature humaine, son lien avec la nature et à l’Absolu. » Le programme est séduisant, mais concrètement ?
J’ai profité de l’une de ces rencontres pour m’asseoir parmi les étudiants, à l’écoute d’Alain Nacache. Au programme du soir, un passage bien connu : l’histoire de Joseph, le fils de Jacob, relatée au chapitre 37 de la Genèse. Joseph et sa tunique de luxe, Joseph, le préféré de son père, Joseph et ses rêves. Alain Nacache est un orateur éloquent. Il présente les faits avec beaucoup d’esprit et décrit les protagonistes de manière vive et colorée. Au passage, on apprend qu’un chapitre entier du Talmud [1] est consacré aux rêves, qui sont signifiants à la condition toutefois d’être récurrents.
Alors que la réflexion se poursuit sur les choix qui se présentent à Joseph, un retour en arrière s’avère nécessaire vers l’histoire d’Ésaü et Jacob, le père de Joseph. « Dans la Bible, explique le Grand Rabin, la problématique de l’identité est exprimée dans la façon dont les protagonistes sont nommés et dans ce qu’ils engendrent. » Deux aspects doivent être distingués : l’identité, qui correspond aux apparences, à ce qui est donné à voir à ceux qui nous entourent, et l’ipséité, qui est ce que nous sommes et qui n’a pas besoin de la reconnaissance d’autrui. Les travaux de Paul Ricoeur sont évoqués [2]. C’est dans l’ipséité que nous trouvons les notions de continuité, de fidélité. « La finitude est ce que je dois accepter de vivre pour accéder au temps long », précise Alain Nacache. Des explications qui viennent en résonnance avec notre notion chrétienne de pèlerinage sur la terre, notre finitude, avant que nos âmes immortelles, ipséité, trouvent le bonheur auprès de Dieu. L’ipséité n’a pas besoin de la reconnaissance d’autrui, mais l’identité oui. « Pourquoi ai-je besoin de la reconnaissance d’autrui, s’interroge le Rabbin ? Pour savoir que ce que je fais est vrai. Mais que veut dire le concept même de vérité ? ». L’occasion d’un détour par Aristote [3] et sa définition de la vérité.
Quand Isaac ne reconnaît pas Jacob, qui s’est couvert les mains et le cou de la peau des chevreaux, pour arracher la bénédiction de son père, c’est que son ipséité a disparu derrière son identité. En Égypte, Joseph doit faire cohabiter deux identités, son identité juive et celle qui lui donnent les Égyptiens, tout en conservant son ipséité. Autant de conflits internes qui poussent à la réflexion.
Avec humour, Alain Nacache multiplie les apartés et nous ouvre peu à peu les portes de la religion juive. Il se présente lui-même comme orthodoxe. « Dans le monde juif orthodoxe, souligne-t-il, la règle de droit est le bien commun. Elle est parfois juste, parfois injuste, mais elle est le bien. Si aujourd’hui le droit civil n’est plus perçu comme juste dans la société, c’est parce que le législateur légifère pour des minorités. Le Talmud fixe des règles pour tous les juifs car nous savons que la tentation de l’individualisme est grande. Le judaïsme est un univers juridique pour le bien de tous. »
Lors de la messe d’ouverture de l’Année sainte, le cardinal Jean-Claude Hollerich, notre archevêque, nous a invité à reprendre la lecture de l’Écriture sainte. Pourquoi ne pas compléter cette lecture en participant au Cercle judéo-chrétien, pour apprendre à mieux connaître la foi juive ?
Le Cercle judéo-chrétien est organisé par le Centre de formation diocésain Jean XXIII, en coopération avec le Consistoire Israélite du Luxembourg et l’ErwuesseBildung asbl.
Les prochaines séances se dérouleront les 3 février, 3 mars, 28 avril, 5 mai, 16 juin et 14 juillet 2025, de 18 heures 30 à 20 heures à la synagogue de Luxembourg.
Inscriptions ici.
Merci d'avoir lu cet article. Si vous souhaitez rester informé de l’actualité de l’Église catholique au Luxembourg, abonnez-vous à la Cathol-News, envoyée tous les jeudis, en cliquant ici.
Gros titres
-
Procession dansante d'Echternach 2025
Mardi de Pentecôte, 10 juin 2025, prier en dansant en l’honneur de saint Willibrord.
-
Abbé Yves Olinger : « il faut vivre sa foi en s’ancrant dans une communauté concrète »
Yves Olinger a longtemps tenu sa vocation à distance. Entretien avec cet ancien instituteur devenu prêtre (dossier "vocations" 5/5).
-
2e épisode du podcast Échos de l’Église au Luxembourg
L'Église catholique au Luxembourg a inauguré une série de podcasts. Marie-Christine Ries est la deuxième invitée.
-
Défrichez vos terres en friche (Osée, 10, 12)
Exemple à suivre : le Doyenné Sud-Est ou ce qui se passe quand l’Église travaille dans l’unité.